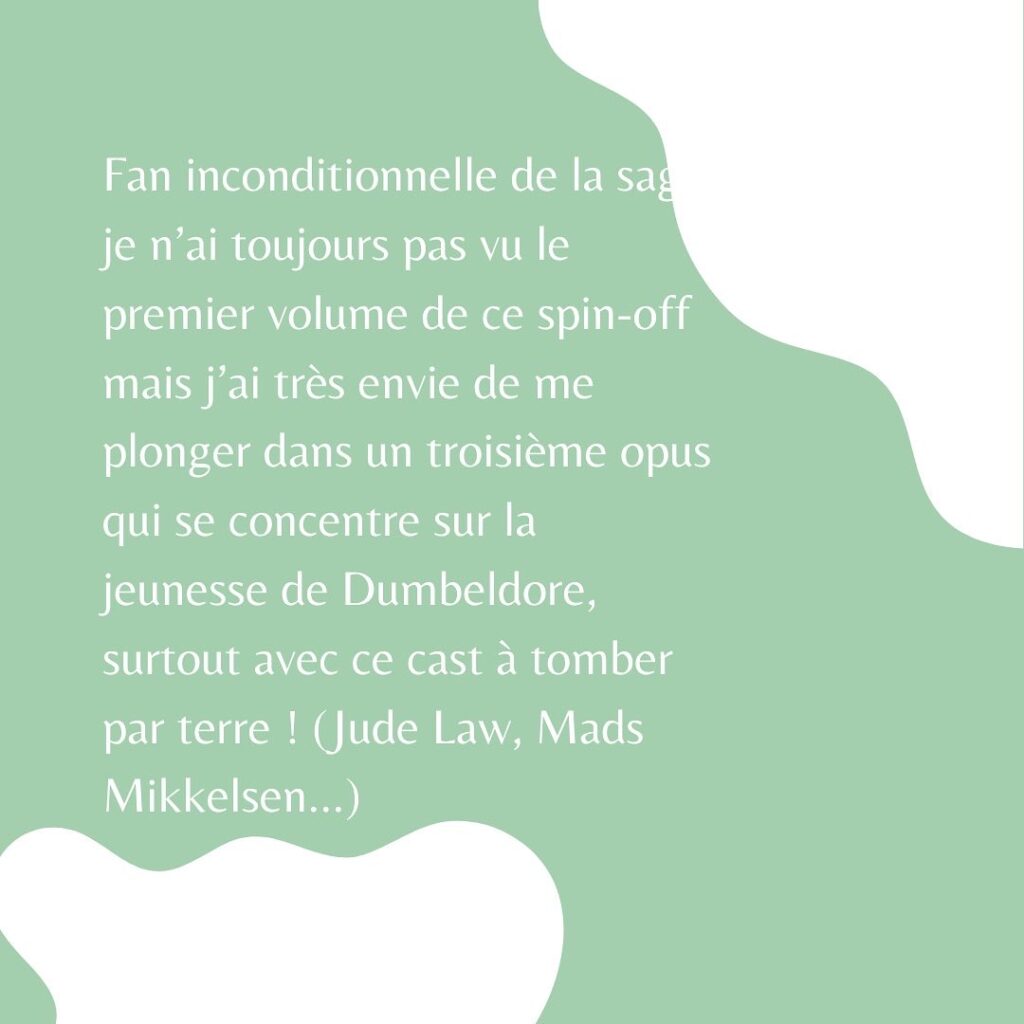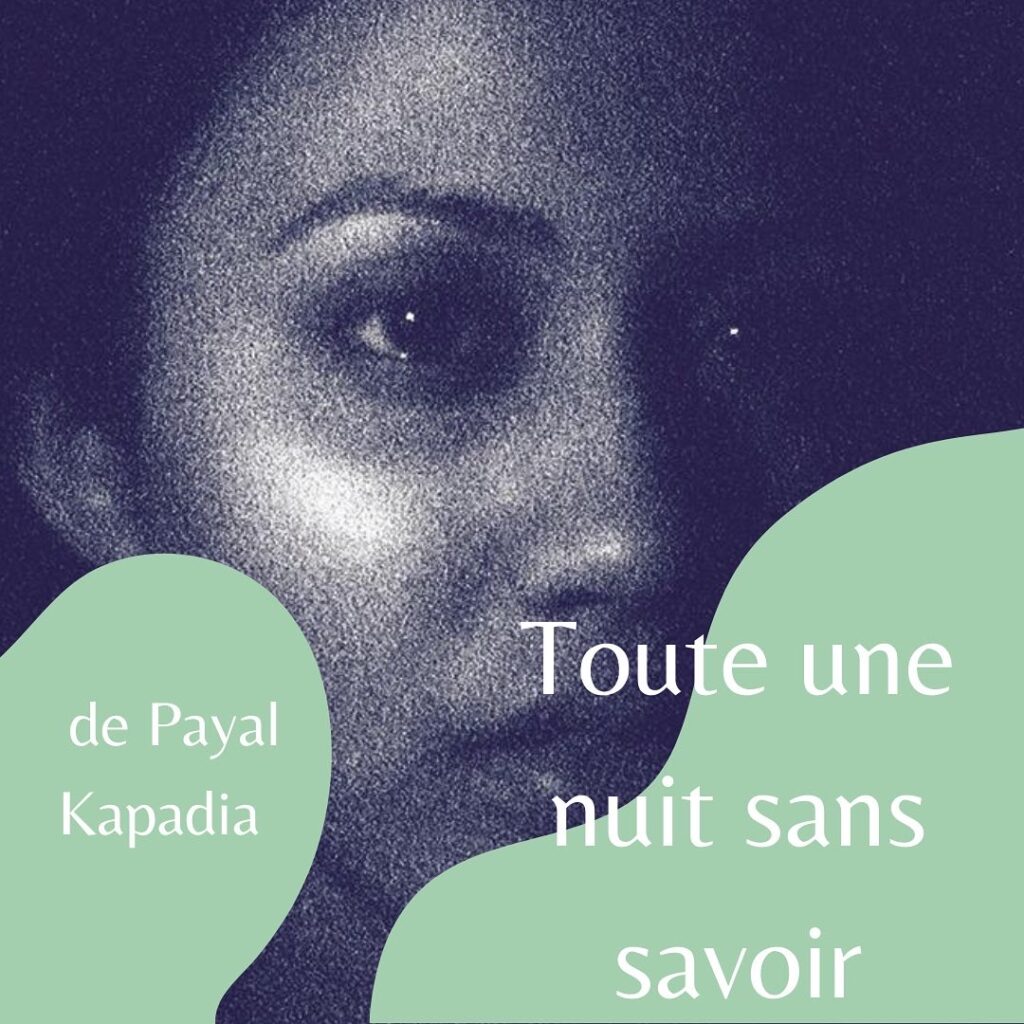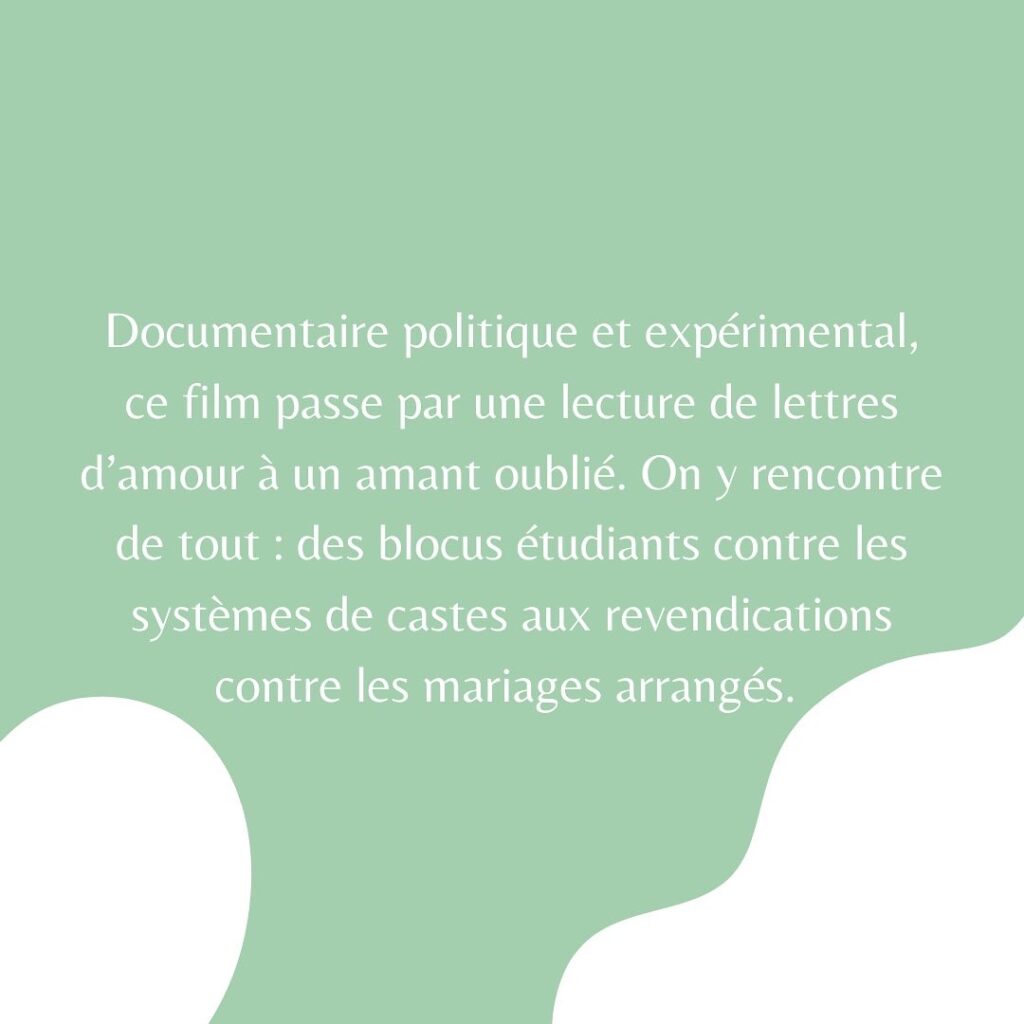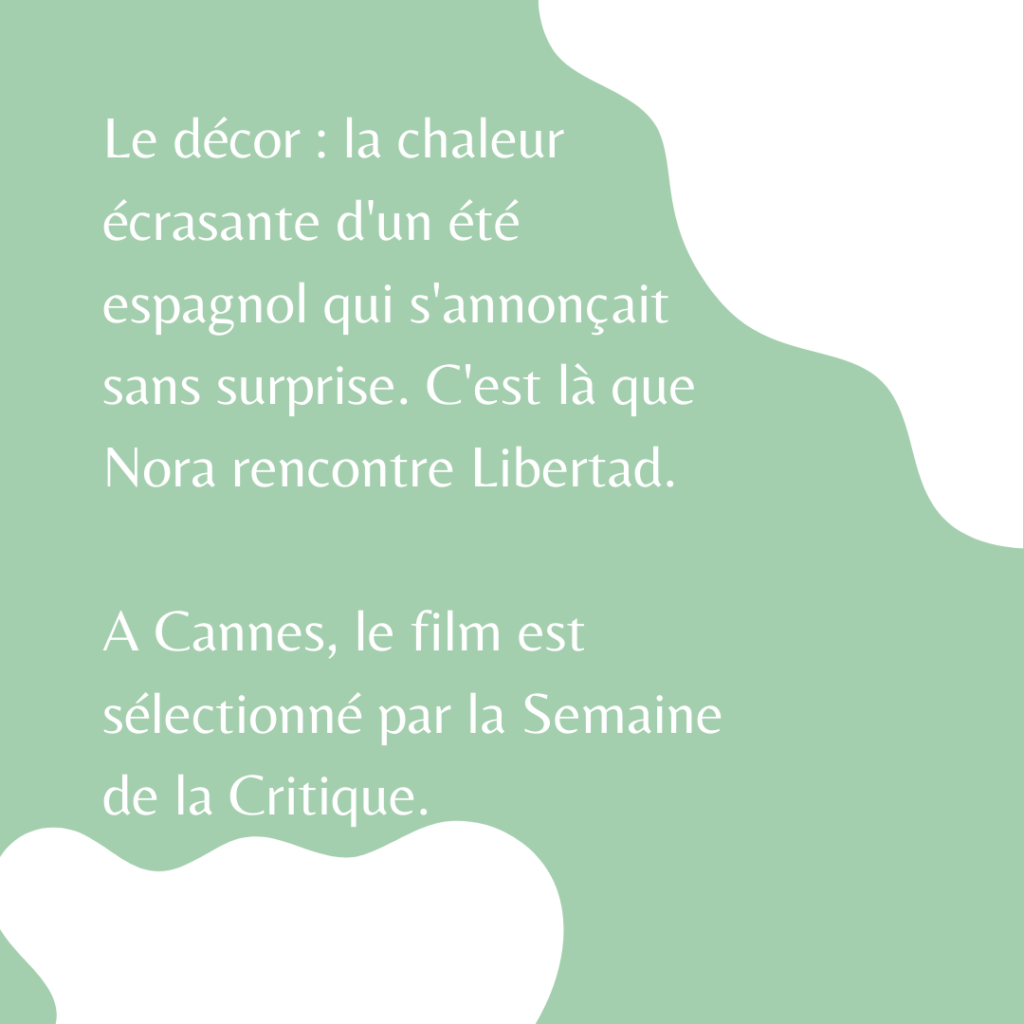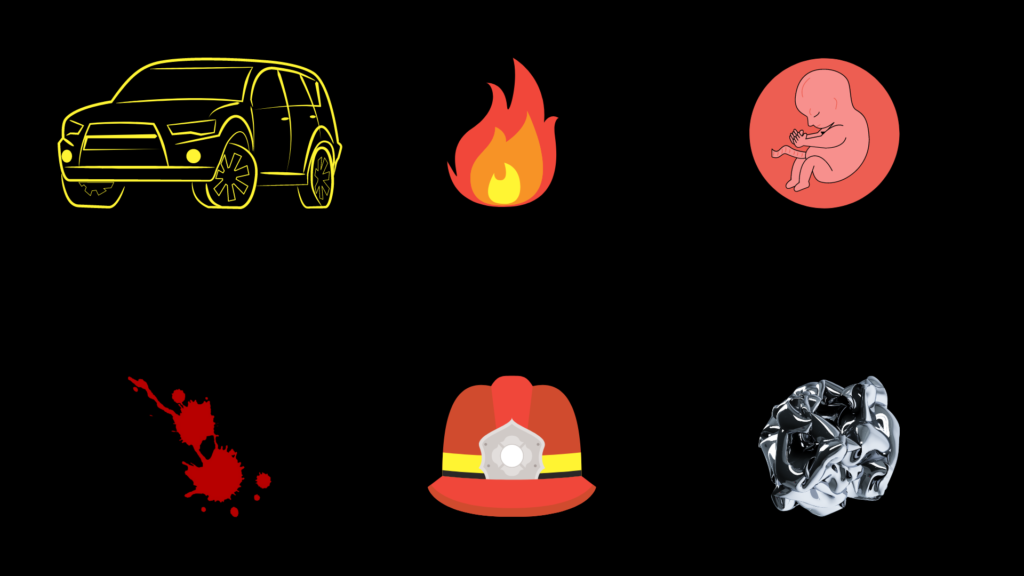Ce qui suit est un journal de bord de mon séjour au 75ème Festival de Cannes. Enjoy !

30 mai 2022
« C’est la fin ». La chanson de Juliette Armanet Le dernier jour du disco tourne en boucle dans ma tête. Célébrer la pose d’un point final, faire bouillonner toute l’énergie d’un moment dans son dernier jour : selon moi, c’est ce qui rend cette chanson addictive, ce qui en fait un hymne à la vie et à tout ce qui est impermanent en elle.
« Le tout dernier matin ». Dimanche, au levé, la fatigue immense, mais habituelle, des nuits cannoises qui sont connues pour être brèves. La dernière fut la plus courte : avec à peine trois heures de sommeil après la soirée d’équipe, je dois aller au bureau pour y plier mes cartons, car tout notre attirail repart désormais vers Paris.
« Ne me lâche pas la main ». La dernière standing ovation de fin de séance, c’est avec Broker (Les bonnes étoiles) de Hirokazu Kore-Eda que je l’ai vécue. Derniers applaudissements longs et émus devant l’équipe du film. Dernier moment de grâce, dernière émotion en observant le visage des acteurs, qui parfois nous étaient inconnus avant le visionnage du film. Dernières étreintes d’équipes de films projetées en grand écran au Théâtre Lumière.
Je repense aux derniers moments et j’ai le sentiment que cette année, beaucoup auraient voulu faire durer le Festival un peu plus longtemps (pas tout le monde, certes, je pense à certains départements du Festival pour lesquels cette période est longue et engorgée de nuits au travail). Vincent Lindon, président du Jury, ironise sa volonté de ne pas terminer son mandat au bout des douze jours. « We need four more years ! ». Derrière cet humour, une tristesse certaine de mettre un point final à cette présidence qui n’arrive qu’une fois dans une vie.
De quoi a été fait le Festival ? De projections, de visionnages de films, de déceptions, aussi, de bonnes réceptions, de critiques incendiaires (le jury aura su offrir une réelle consolation à Claire Denis !), de changement de vies, de nouveaux talents… Au bout du compte, probablement, d’un amour sincère pour le septième art.
Douze jours. Pour moi, le Festival a duré bien plus longtemps. Il commence au début de mon entrée dans l’équipe en tant que stagiaire, en mars, à Paris, et s’intensifie à la semaine d’arrivée à Cannes, début mai. Trois semaines sur place, pour préparer ce qu’on dénomme toujours « le plus grand Festival de cinéma du monde ».
A mon arrivée, j’essaie de prendre des notes sur ce que l’on vit chaque jour. Malheureusement, le rythme effréné de l’événement m’empêchera bientôt de tenir cet engagement. En attendant, voici ce qu’il m’en reste.
8 mai 2022, neuf jours avant le festival
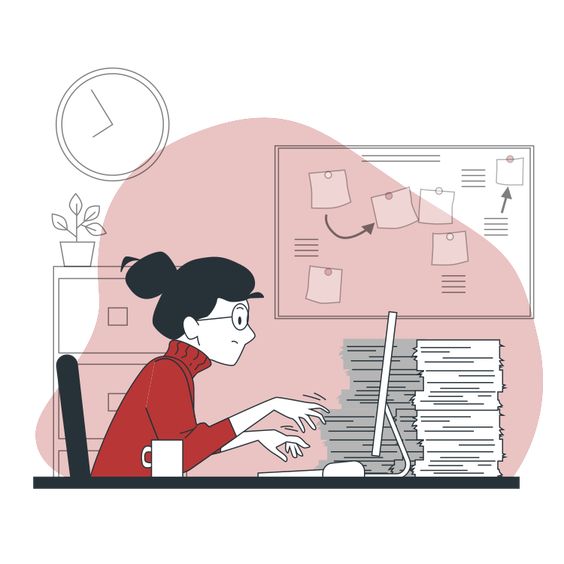
J’ai pris le train pour Nice hier. Arrivée à Gare de Lyon, j’ai reconnu un certain nombre de personnes du Festival. On s’est vite engouffrés dans le train. Le voyage commence.
Pour la première fois de ma vie, je vais pouvoir assister au Festival de Cannes de l’intérieur. J’ai été de nombreuses fois une grande fan de l’amour du cinéma et du star système qu’il représentait. Cette année, je vais suivre l’organisation derrière le décor.
Aujourd’hui, premier jour à Cannes. Nous nous retrouvons dans une pizzeria hautement perchée de la ville afin de prendre des forces pour notre première vraie journée cannoise du Lundi. Demain, nous irons tous travailler au Palais des Festivals, le lieu emblématique qui reçoit chaque année le faste du Festival de Cannes.
Samedi 14 mai
Comme j’ai la chance d’avoir ma famille à Nice, je passe mon jour de repos dans une autre ville magnifique de la Côte d’Azur. Pour moi, en fait, beaucoup plus belle que Cannes, plus attachante et plus vivante. Nice est une ancienne ville italienne, on aperçoit de ses hauteurs ses criques et le bleu turquoise de son eau. Mais elle est aussi parée d’un vieux quartier et de son marché, d’une place aux couleurs rouge et jaune et au sol en damier : tout cela et encore plein d’autres choses font de Nice une ville multiple et vivante. Cannes, à côté, est une ville de vacances étonnante et majestueuse, mais elle paraît vivre constamment autour du Festival.

Dans tous les cas, je retourne ce soir à Cannes, pour un pot d’équipe. C’est là que je note cette réflexion que je me fais au moins depuis hier : ce qui est le plus impressionnant pour l’instant, dans la préparation du Festival, c’est pour moi la transformation physique du Palais. Tous les jours, on assiste depuis l’extérieur au montage de ce qui seront les marches du Festival de Cannes. Entre mon bureau et celui de mes collègues préférées, que je vais voir souvent, c’est carrément un café qui se construit (note : j’apprendrai plus tard qu’il s’agit du Wifi Café, un endroit réservé aux journalistes). Avant de partir à Cannes, on parlait du déménagement depuis Paris. En effet, j’ai l’impression d’emménager pour une nouvelle vie pour trois semaines. Mardi, tout devra être prêt : les affiches, les salles, le café entre nos deux bureaux.
Du reste, lorsque je gambade librement dans le Palais, j’adore me faufiler discrètement dans le Grand Théâtre Lumière. L’émotion est incomparable à toute autre. J’ai tellement vu et revu cette salle à la télévision. En 2019, j’y visionnais les Misérables et Bacurau pour la première fois, avec mon Pass 3 jours. C’est une salle historique, emblématique et c’est émouvant d’être seule en y rentrant, et de se sentir pour une fraction de seconde maîtresse des lieux. J’imagine Julia Ducournau sur scène, l’an dernier, recevant sa Palme.
Dimanche 15 mai
« Y a pas de caméra dans ma tête ». C’est ce que répond Truman à celui qui se pose comme son créateur, celui qui sait tout de lui, sous prétexte qu’il ait pu filmer tous les instants de sa vie, dans le film The Truman Show. Je pourrais redire cela aujourd’hui, il n’y a pas de caméra dans ma tête. Ce serait beaucoup plus simple de raconter toute cette expérience, pourtant, s’il y en avait une, de petite caméra dans mon cerveau. Pour suivre tous les grands moments du festival. Plus besoin de penser à écrire, à vlogguer, à prendre des photos, si l’on pourrait lire sa mémoire comme une clé USB.
Aujourd’hui était le dernier dimanche avant le festival. A l’ordre du jour, le dernier discours de Pierre Lescure devant ses équipes.
Si on avait une caméra dans ma tête, on saurait que la tension monte terriblement avant le jour J.
Mon responsable m’a fait découvrir encore un peu mieux le Palais. J’ai pu faire un grand tour, voir les toutes petites salles de cinéma réservées au marché, et les plus grandes. La salle Buñuel, presque en forme de banane. C’est un beau palais, immense, un monstre qui tient en son entre tous les plus gros bijoux du cinéma. C’est impressionnant d’y travailler. Dans ce grand ventre du cinéma, je n’ai pas accès à tout, ça me frustre et dans le même temps je connais ma chance d’y être et de m’y balader tranquillement.
Lundi 16 mai 2022
Le Festival commence demain et aujourd’hui, pour la première fois, le Palais est ouvert aux accrédités et au public. En descendant à la billetterie, au Hall Méditerranée, on voit le monde s’y agglutiner, aller chercher ses billets, espérer avoir une place pour telle ou telle projection. Demain, à 18h30, tout cela va vraiment commencer. Depuis la fin du dernier Festival, les équipes que j’ai rejointes en mars s’activent pour construire un événement de douze jours. Le compte à rebours termine demain, et c’est assez fou d’y penser !
Bonjour aux projections, aux artistes, au revoir aux protections sur le sol et aux peintures dues aux travaux. Hier l’affiche se hissait pour la première (et dernière) fois sur la grande façade du Palais, en haut des marches. Cette affiche-ci est particulière, parce qu’elle fait en sorte que lorsque l’on montera des marches, encore un certain nombre nous attendront plus haut.

Et aujourd’hui, quelque chose d’assez fou s’est produit : alors que j’avais complètement perdu espoir en l’idée d’aller à l’ouverture, voilà que l’on m’offre de m’y emmener. Donc, demain, je serai dans la salle en même temps que le jury et les équipes de films. C’est carrément vertigineux, on pense à avec quoi on va s’habiller, se coiffer… C’est tout un processus, le fait de se diriger vers cette cérémonie. Depuis quelques soirs, je n’ai plus très envie de sortir et je me plais beaucoup à rester chez moi, à regarder des bribes de films à la télé (hier, La Belle Epoque de Nicolas Bedos, aujourd’hui, Elle de Paul Verhoeven, deux films qui sont allés à Cannes…), à écrire en même temps et à aller me coucher tôt. Demain, ce sera un tout autre genre de soirée, un truc auquel j’ai pensé il y a des années de ça ; parce que je me rappelle bien que déjà, à 13 ans, c’était une ambition précise que d’être dans cette salle le soir de l’ouverture un jour dans ma vie.

Je respire la mer, je touche du doigt les sièges du Grand Théâtre Lumière, c’est un peu tout ça qui me fait entrer dans le cinéma, tout ça et la perspective de projets, de films, de créations qui semblent à la fois si loin et si proche.
Dimanche 22 mai
Aujourd’hui, une nuit très courte suivie d’une matinée de travail, d’un déjeuner à la pizzeria Salsa Rossa, près du marché, qui est absolument divine ; puis une petite sieste avant d’enchaîner à nouveau les films. Le premier, c’est le premier film de Charlotte Lebon : Falcon Lake. S’il a du mal à démarrer, le film a fini par largement me conquérir par sa sincérité, sa vérité (surtout lorsqu’on s’intéresse à la naissance du sentiment amoureux chez les adolescents), mais aussi par sa photo, absolument magnifique, ses acteurs attachants… Son côté décalé et presque perturbant. J’ai été complètement conquise, je le répète, par la mise en scène de Charlotte Lebon de vacances d’été sombres et belles, pleines de contrastes et d’amour.

Le soir, je monte les marches pour Novembre, le film de Cédric Jimenez, que j’ai aperçu hier dans la file d’attente pour le film de Quentin Dupieux, Fumer fait tousser. Aujourd’hui, je vais découvrir ses acteurs et son film. Finalement, une certaine déception s’installe lorsque l’on compare ce long-métrage à son précédent, BAC Nord, un film qui m’avait profondément marquée par son intérêt cinématographique.
________________________________________________________________________________
Après le 22 mai, je ne retrouve pas de notes. Novembre de Cédric Jimenez est le huitième film que j’ai la chance de visionner, sur un total de treize en douze jours. Dans la dernière semaine, la chaleur se fait peu à peu écrasante sur la croisette. Les salles de cinéma deviennent un refuge pour l’esprit mais aussi pour le corps. En salle Agnès Varda pour le film de Park Chan Wook, la seule salle entièrement construite pour le Festival, sous un chapiteau à l’extérieur, l’orage arrive enfin pour purger ces derniers jours d’immense chaleur. On entend la pluie tomber fortement et le tonnerre gronder, je me demande si une salle qui n’a que quelques jours de vie de prévus sera assez forte pour nous en protéger. Le son de l’orage s’incruste en fait très bien dans celui du film.
Je vois ensuite Nostalgia, le premier film qui devant lequel l’épuisement se fait ressentir et je pique du nez. Les images de Naples m’apaisent et finissent par se présenter à moi comme une douce berceuse visuelle.
La dernière projection à laquelle j’assiste est celle des courts-métrages. Les réalisateurs et réalisatrices sont très inspirants, souvent novices, et donnent envie de se plonger dans la création cinématographique.
Je n’ai pas envie de parler plus que cela de la cérémonie de clôture. J’ai une pensée émue pour l’heure d’après, lors de laquelle nous prenons des coupes de champagne sur la terrasse du Palais à laquelle nous avons déjeuner les trois dernières semaines. Entre collègues, on se remercie d’avoir été là les unes pour les autres. C’est un moment où l’on met des mots sur ces liens qui et qui se sont renforcés lors de cette période unique. J’ai un sentiment qui ressemble à celui d’une dernière représentation au théâtre avec ma troupe. Les larmes montent vite. Quelque part, je ne suis pas triste, ou plutôt c’est une tristesse que j’aime. C’est celle qui fait réaliser que ce que l’on a vécu a été beau et sincère, même si l’on ne se l’est pas dit. C’est celle qui fait penser que l’on a aimé ce qui a été. On jette un coup d’œil en bas de la terrasse. A l’entrée des artistes, s’affairent et s’affolent les journalistes et les photographes, à l’affût de quelques mots des lauréats. On se sent encore loin de tout cela.
A 5 : 30, il est temps de rentrer, d’aller dormir une dernière fois dans ma location saisonnière de Cannes. Je longe la croisette alors que le soleil se lève sur elle. Je pense aux premières pages de La Promesse de l’aube, de Romain Gary : « C’est fini. La plage de Big Sur est vide, et je demeure couché sur le sable, à l’endroit même où je suis tombé. ». Les plages de Cannes sont vides.

C’est la fin de cet article ! Merci infiniment d’avoir pris le temps de le lire jusqu’au bout. N’hésitez pas à m’en faire un retour sur Instagram (@laissetomberlesfilms). A très vite !
Inès